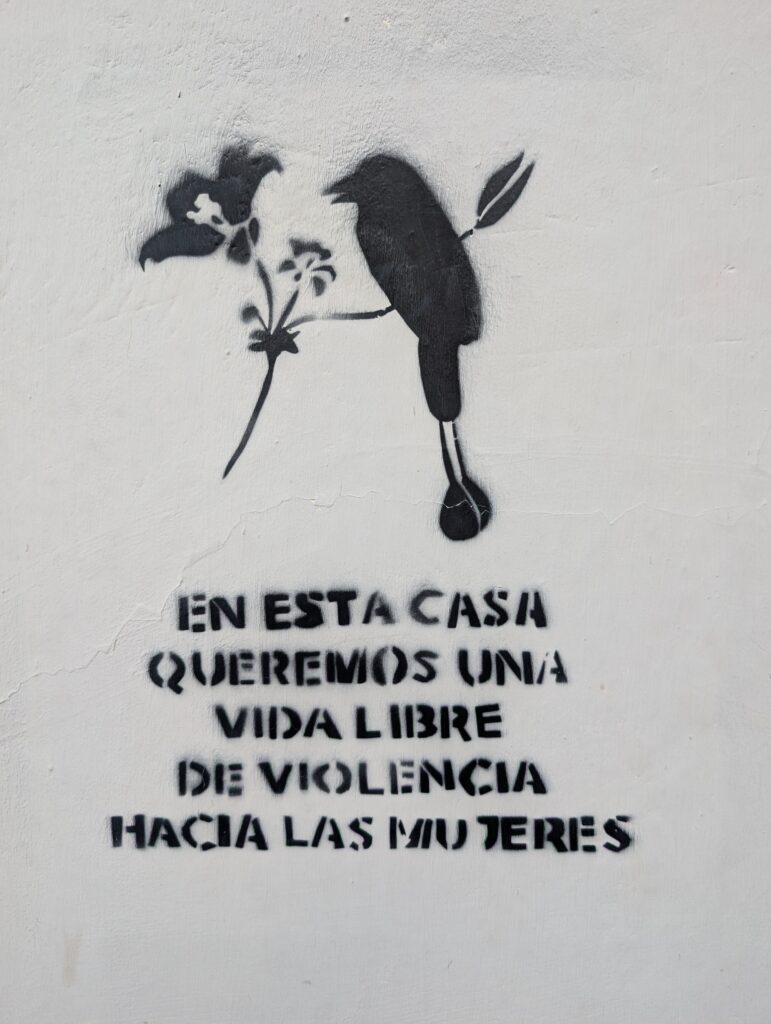Santa Ana → Suchitoto – 2 h de bus, puis 45 min, puis 1 h (100 km en tout)
Le Salvador, c’est le plus petit pays d’Amérique Centrale, qui ne contient déjà pas vraiment des géants : 21 000 km², en gros un rectangle de 200 km par 100. Soit environ la taille de 2-3 départements français (ou autant que la Slovénie, mais ça vous parle peut-être moins). En revanche, avec plus de 6,5 millions d’habitants, il n’y a pas vraiment d’espaces vides, et c’est de loin le pays le plus densément peuplé d’Amérique. Une topographie assez typique de la région, avec dans l’ordre : le Pacifique et ses rouleaux ; une plaine côtière plus ou moins large, avec quelques stations balnéaires réputées chez les surfeurs ; une chaîne de 20 volcans plus ou moins actifs, puisqu’on est toujours en plein sur la ceinture de feu (avec gros séismes à la clé) ; un plateau central assez conséquent qui héberge la majeure partie de la population ; et enfin une petite chaîne de montagnes plus classiques, qui marque la frontière avec le Honduras. Situation environnementale assez catastrophique, notamment en terme de pollution des eaux et de déforestation : petit territoire et forte population défavorisée, ça se marie rarement avec « protection de l’environnement »…
Au début du XVIème siècle, les Pipils, une tribu de Nahuatls ayant quitté le centre du Mexique, sont bien installés dans la région centrale du Salvador, à la tête du « royaume » de Cuzcatlan. Puis les Espagnols arrivent. Vous connaissez la suite… À noter que les Pipils ne se sont pas vraiment laissés faire au début, et qu’ils ont cramé à plusieurs reprises les premières tentatives de colonies espagnoles. Ça n’a malheureusement pas duré. Autre petite particularité : à partir du XVIIème siècle, le Salvador devient l’un des plus grands producteurs mondiaux d’indigo, histoire de changer de la banane et du cacao. Ensuite on est sur du déjà-vu : indépendance (1821), Empire mexicain, République Fédérale d’Amérique Centrale, deuxième indépendance (1841), semi-guerre civile entre libéraux et conservateurs, république caféière (1876 – 1931) – oui c’est comme une république bananière, mais avec du café…
1932, l’année la plus noire de l’histoire du Salvador : motivés par le parti communiste suite à un coup d’état fasciste soutenu par l’oligarchie au pouvoir, fatigués par la misère et l’exploitation, des milliers de paysans, majoritairement d’origine indienne, sortent les machettes et s’en vont s’attaquer aux grandes propriétés terriennes. Ils feront une vingtaine de morts. En réaction, le gouvernement, aidé par les Britanniques et les Américains, massacrera environ 25 000 indiens (le nombre est toujours inconnu, certains évoquent jusqu’à 40 000 tués), sous prétexte d’éradiquer la menace bolchévique… Résultat : les survivants abandonneront us et coutumes pour éviter une autre tuerie ; et c’est désormais le pays de la zone avec la plus faible population indienne…
Les fascistes garderont le pouvoir plus ou moins jusqu’à la fin des années 70, avec quelques brèves interruptions sanglantes. Puis on enchaîne sur une nouvelle guerre civile contre les partis de gauche : la guérilla démarre en 79, et va rapidement devoir faire face à des escadrons de la mort (paramilitaires d’extrême-droite financés par le gouvernement salvadorien et, plus discrètement, par la CIA), qui commettront d’abominables massacres. Une jolie citation d’un évêque engagé au côté des paysans dans la lutte politique : « Les pays étrangers, dans leur désir d’hégémonie mondiale, fournissent les armes. Le peuple salvadorien fournit les morts. »
Quand la guerre civile prend officiellement fin en 1992, ce sont les gangs qui rappliquent et prospèrent sur le fertile terreau qu’est le Salvador en ruines. Le cauchemar ne semble pas devoir se terminer un jour… Sauf que Bukele finit par débarquer et mettre tout ce petit monde en prison, sans guère de considération pour les droits humains. Vous comprenez désormais un peu mieux pourquoi il a la cote auprès de sa population : peut-être pour la première fois depuis cinq siècles, les Salvadoriens ne craignent plus pour leur vie. Un net progrès, vous en conviendrez.